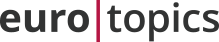Après Anchorage et Washington, un espoir pour la paix ?
Après les sommets d'Anchorage et de Washington initiés par le président américain Donald Trump, la presse européenne s'interroge sur la paix en Ukraine, les mesures à prendre pour y parvenir et le rôle des différents pays.
Trump veut dicter ses règles
Expresso évoque la vision du monde qui sous-tend l'action du président des Etats-Unis :
«Trump semble déterminé à être un médiateur actif et désireux d'imposer ses choix. Il écoute les deux camps et croit qu'il pourra leur imposer au final les conditions de la paix. ... Cette Amérique n'a rien à voir avec celle des dernières décennies. Elle n'est ni le fer de lance de l'Occident, ni le cœur du monde libre. Elle est une puissance dont l'intérêt consiste à réviser l'ordre international, une puissance qui se soucie de l'accès à des ressources naturelles devenues de plus en plus cruciales, et une puissance qui entend dicter aux autres ses règles, ainsi que ses conceptions de la paix et de l'ordre.»
L'approche judicieuse de Berlin
Dans Magyar Hang, le théologien István Zalatnay salue la position du chancelier Friedrich Merz :
«Merz a reconnu que la première mesure logique pour parvenir à un développement judicieux ne pouvait être qu'un un cessez-le-feu. ... Si Trump se laisse convaincre, alors on pourra envisager que le processus censé mettre fin à la guerre suive une chronologie rationnelle. Avec un cessez-le-feu comme condition sine qua non, qui puisse être assorti d'une déclaration de principe allant dans le sens d'un traité de paix. Ensuite, bien plus tard, quand les intentions et les efforts mutuels le permettront, on pourra envisager de signer un accord de paix qui ne soit pas un diktat.»
Mieux vaut livrer des Taurus
Les débats relatifs au déploiement de soldats en Ukraine sont prématurés, juge le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung :
«Il est plus plausible d'imaginer Trump se voir décerner le Nobel du président le plus intelligent de tous les temps que de penser que Poutine acceptera le déploiement de soldats de l'OTAN à la frontière avec la Russie. ... Plutôt que de s'employer à échafauder des scénarios qui sont de toute façon inenvisageables actuellement, l'Occident ferait mieux de se concentrer sur un point plus important et plus urgent : aider l'Ukraine plus résolument encore dans son combat existentiel, notamment en lui fournissant des armes. Il faut que l'Allemagne livre enfin des missiles Taurus à Kyiv, car ce serait aussi un message clair envoyé à Poutine. Or même la coalition CDU-SPD préfère, dans le doute, discuter d'une mission de paix - aussi irréaliste que celle-ci puisse paraître.»
La Corée du Nord en modèle
Le portail e-vestnik compare la Russie à la Corée du Nord :
«Les parties de l'Ukraine qui ont été conquises par la Russie pourraient devenir une sorte d''Ukraine du Nord'. En pratique, toute la Russie est prête à devenir comme une grande Corée du Nord, une dictature militarisée, qui brandit la menace des armes nucléaires et se trouve isolée du reste du monde, du moins de sa partie développée. On peut comparer la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska à celle entre Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un, lors de son premier mandat. Des paroles en l'air, des sourires et rien de concret. A l'époque, Trump avait témoigné un respect indu au dictateur nord-coréen et renforcé le statut de protagoniste international de ce dernier. La même chose vient de se produire avec Poutine.»
Les risques du leadership français
Helsingin Sanomat se dit préoccupé par la place grandissante prise par Paris :
«La France est une puissance militaire européenne, une puissance nucléaire, un grand fabricant d'équipements de défense et elle exerce une grande influence dans l'Union. Il en résulte un leadership incontesté dans une Europe menacée par la Russie. ... Le revers de la médaille, c'est que les rapports de force politiques pourraient évoluer en France en 2027. Or d'ici là, Macron aura placé son pays dans une position qui pourrait devenir dangereuse pour l'Europe. Car si l'extrême droite, en tête dans les sondages, arrivait au pouvoir à l'issue des élections, la position de la grande puissance européenne vis-à-vis de la Russie et de la coopération européenne pourrait évoluer.»
Un sommet tripartite prématuré serait dangereux
Dans un post Facebook relayé par NV, la diplomate Lana Zerkal évoque un piège :
«La pire des options, à ce stade des négociations, serait d'organiser un sommet tripartite Zelensky-Trump-Poutine. Ce serait un véritable piège, et j'espère que je ne suis pas la seule à en avoir conscience. Un tel format ne pourra être envisagé que lorsque tout aura été réglé, que des accords auront été élaborés dans le cadre de groupes de travail communs et les textes des traités finalisés. Une Europe unie doit chapeauter les négociations avec les Russes - négociations dans lesquelles chaque allié devra apporter son expertise diplomatique sur la façon de composer au mieux avec la stratégie russe.»
Le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine
Dans Új Szó, le politologue et analyste Balázs Jarábik évoque la situation peu enviable du gouvernement ukrainien :
«Après les gros doutes soulevés par la rencontre en Alaska, celle de Washington a quelque peu rassuré Kyiv, mais seulement parce qu'on l'a mesurée à l'échange scandaleux de février. A Kyiv, où je me trouve actuellement, on sait parfaitement que la guerre n'est pas viable à long terme. La pénurie de soldats et une relève insuffisante ont un effet usant sur l'armée, sur laquelle repose l'ensemble de l'Etat. Dans le même temps, Kyiv ne peut pas renoncer au reste du Donbass, car un tel compromis mettrait à rude épreuve la cohésion du pays et sa sécurité. Zelensky essaie de gagner du temps - mais le temps joue contre l'Ukraine.»
Trump a son propre agenda
La paix n'est pas le véritable objectif des sommets organisés par Trump, critique T24 :
«Après la rencontre en Alaska, Trump a abandonné l'idée d'un 'cessez-le-feu rapide' pour embrasser celle d'une paix globale, voulue par le Kremlin. Mais cette politique semble être davantage une opération de communication qu'un processus de paix. ... La paix promise par Trump se trouve réduite à un arrangement entre hommes puissants désireux de préserver leurs intérêts. La vision de Trump d'une 'grande paix' ressemble davantage à une récompense pour le Kremlin, à une hypothèque pour Kyiv et à la possibilité de léguer au monde un semblant de paix, et non une solution pérenne pour l'Ukraine.»
Dans le pire des cas
Seznam Zprávy déroule ce qui pourrait être le pire des scénarios envisageables :
«Si sa santé ne lui joue pas de mauvais tours, Trump restera encore trois ans et demi au pouvoir et pendant ce temps, le monde se lassera probablement des rencontres au sommet. Pendant ce temps, la Russie, soutenue par l'Iran, la Chine et la Corée du Nord, conquerra lentement des milliers de kilomètres carrés de nouveaux territoires [en Ukraine]. L'opinion russe, paralysée par la peur comme à l'ère stalinienne, s'abrutira en buvant la propagande d'Etat et la vodka bon marché. En Europe, la cinquième colonne, sous la forme de différents partis anti-UE et prétendument anti-élite, mais en réalité pro-russes, mineront le consensus social - à savoir qu'il faut tenir tête à la Russie.»