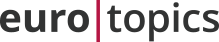Que cherchent les Etats-Unis au Venezuela ?
Les Etats-Unis accentuent la pression sur le Venezuela et son dirigeant Nicolás Maduro. Au cours des dernières semaines, l'armée américaine a tué au moins 80 personnes lors d'attaques contre des bateaux soupçonnés par Washington de transporter de la drogue. Le plus grand porte-avions de la marine américaine a également été déployé dans la région. Les médias européens évaluent les probabilités d'une intervention militaire et font des parallèles historiques.
Eviter un avant-poste de Washington
Trouw redoute un scénario comparable à celui de la guerre en Irak :
«Il semble que Washington n'ait pas tiré les leçons de cette débâcle et s'en serve comme modèle à appliquer au Venezuela. Pour l'Europe, une chose doit être claire : les méthodes que les Etats-Unis emploient actuellement sont contraires au système international. Car il est possible d'interpeller et de critiquer un dirigeant politique sans porter atteinte à la souveraineté de son Etat. La guerre en Ukraine nous a également rappelé l'importance de ce principe : aucun pays ne devrait pouvoir en assujettir un autre.»
Le traffic de drogue n'est qu'un prétexte
WOZ rappelle comment les Etats-Unis ont autrefois accusé Manuel Noriega, alors au pouvoir au Panama, de trafic de drogue :
«L'invasion [du Panama] en décembre 1989 n'avait pas pour objet la drogue, mais le canal de Panama. … Dans les années 1980, Noriega ne souhaitait plus que son pays continue à accueillir l'armée américaine, ce que l'ancien président américain George Bush senior n'a pas accepté. Les menaces actuelles à l'encontre du Venezuela n'ont pas pour cible véritable les mafias de la drogue. Le Venezuela joue un rôle mineur dans le trafic de drogue. Seuls 8% de la cocaïne introduite clandestinement aux États-Unis transitent par ses côtes. Les drogues de synthèse telles que le fentanyl proviennent toutes du Mexique. Ce qui intéresse davantage Trump au Venezuela, ce sont ses réserves de pétrole, réputées pour être les plus grandes au monde. Tant que Maduro sera au pouvoir, il n'y aura pas accès.»
Pari risqué
Neue Zürcher Zeitung pèse le pour et le contre :
«Si le régime Maduro venait à s'effondrer, les perspectives de démocratisation seraient bonnes. Car contrairement à l'Irak et l'Afghanistan, où des initiatives de 'nation building' avaient également été entreprises, le Venezuela dispose d'une tradition démocratique. … Evidemment, une attaque américaine ne se ferait pas sans risque. L'armée pourrait prendre le pouvoir sous la houlette d'un nouveau dirigeant en empêchant un retour à la démocratie. Ou se fracturer entre partisans et opposants du régime, qui finiraient par s'affronter. Mais le régime de Maduro manque tellement de légitimité que sa fin définitive est plus probable.»
La volonté du peuple vénézuélien ne compte pas
The Economist revient sur les récentes déclarations des deux capitales, qui se disent prêtes à engager des discussions :
«Beaucoup dépendra de la stratégie que Donald Trump jugera la plus appropriée pour se donner en spectacle dans les médias : obtention d'un accord par la force militaire ou attaque spectaculaire et ciblée visant à renverser Maduro, voire à le tuer. ... Trump est imprévisible. ... Parmi les scénarios possibles, rares sont ceux qui correspondent à ce pour quoi la plupart des Vénézuéliens ont voté l'année dernière : un pays démocratique sans Maduro.»