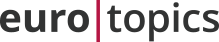Conflits internationaux : quel rôle l'Europe peut-elle jouer ?
Avec les guerres au Proche-Orient et en Ukraine, et la recomposition des rapports de force politiques, les regards se portent en premier lieu sur la superpuissance militaire américaine. Les chroniqueurs se demandent comment l'Europe, pour sa part, devrait se profiler sur la scène internationale.
Le continent est dépassé
Expresso écrit :
«On comprend pourquoi l'Europe n'est pas présente. Elle n'a pas le pouvoir de mettre sous pression l'un des deux camps. Elle ne dispose pas de porte-avions qu'elle pourrait déployer dans la région, de bombardiers pour menacer le programme nucléaire iranien, ni d'affaires juteuses à conclure avec les monarchies du Golfe. Et même si c'était le cas, elle ne serait pas prête à les mobiliser ou à menacer de le faire. ... Nous vivons à une époque où la puissance de la diplomatie dépend pour l'essentiel de la disposition à recourir à la force, ou à conclure des affaires entre Etats – plutôt qu'entre des économies. L'Europe n'en est pas encore là.»
L'UE devrait se concentrer sur l'Ukraine
L'UE à des choses plus importantes à faire que de s'engager au Proche-Orient, où elle ne joue aucun rôle actuellement, fait valoir Die Zeit :
«A savoir assurer sa propre survie en tant qu'Union. Cela n'est pas en jeu au Proche-Orient ; mais c'est le cas en Ukraine, où Vladimir Poutine poursuit sa croisade impérialiste avec la dernière rigueur. Voilà pourquoi les responsables des trois agences de renseignement allemandes ont formulé publiquement des avertissements sans ambages : 'Il ne faut pas baisser la garde et penser qu'une agression russe se produira au plus tôt en 2029. Nous sommes déjà en conflit'. ... L'objectif de Poutine est de démanteler l'UE. L'UE doit mobiliser toutes ses forces pour proscrire cette perspective – dans le cas contraire, on se dirige vers une ère où l'Europe sera morcelée en petits Etats. Aucun Européen et aucune Européenne ne peut désirer cette perspective.»
Il ne s'agit pas seulement de Kyiv
Új Szó discerne une restructuration de l'ordre mondial :
«Fin 2025, la guerre est devenue une mise à l'épreuve de la patience, des ressources et de la légitimité. Moscou est militairement plus forte, Kyiv s'épuise graduellement, l'Occident est divisé et impuissant – il ignore ce que 'victoire' signifie pour lui. Le débat sur les Tomahawk, les attaques visant le système énergétique et la question de la confiscation des avoirs russes gelés profèrent la même mise en garde : il n'en va plus de l'Ukraine dans ce conflit, mais de la réorganisation de l'ordre mondial – et personne ne contrôle plus rien.»
La nécessité d'une réorientation stratégique
L'Europe a besoin de moyens de pression pour tenir en échec les agresseurs, écrit l'analyste politique Miguel Baumgartner dans O Jornal Económico :
«Certains disent qu'on ne négocie pas avec ceux qui bombardent. C'est compréhensible. Mais on négocie toujours avec des ennemis, pas avec des amis ; avec des amis, on organise des réunions au sommet. La question est de savoir qui fixe les conditions. Si c'est Washington et Moscou (ou Ankara et Moscou), l'Europe paiera deux fois : en matière de budget et en termes de sécurité, avec des frontières fragiles et un précédent funeste. Une Europe mature a besoin d'un 'centre européen pour la paix', non pas pour récompenser les agressions, mais pour mettre en œuvre un processus qui aurait pour conséquence que les coûts d'une poursuite [de la guerre] seraient plus élevés que de mettre fin à celle-ci.»
Seule une défense forte peut garantir la paix
Les pays faibles militairement sont une proie de choix pour les agresseurs, juge le quotidien Kleine Zeitung :
«Si l'on regarde les pays européens, on constate un véritable fourre-tout en matière de défense. Service militaire obligatoire, suppression du service militaire, service supprimé avec des obligations en cas de force majeure, service volontaire pour les hommes et les femmes, volontaire seulement pour les hommes, entre quatre et douze mois. On voit, à l'exemple de l'Allemagne, combien il est difficile de réviser le statu quo. ... Après des décennies de rêves, force est de constater que seule une défense forte peut garantir la paix – un Etat faible et facile à conquérir n'a aucun atout en main face à un agresseur potentiel. Plus important encore, il n'est pas seulement question du nombre de soldats, mais aussi de leur attitude au combat.»